- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
La réalité derrière le fantasme de la justice robot
La réalité derrière le fantasme de la justice robot
La justice « bouton » fait vendre autant qu’elle fait peur. Décryptage d’un concept qui jure de transformer la justice.
par Thomas Coustetle 15 avril 2019
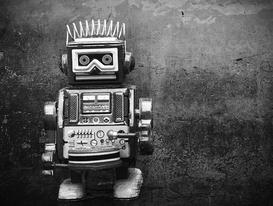
Utiliser les algorithmes pour prévoir l’issue d’une action en justice. Voici la promesse de la justice prédictive. Le rapport Cadiet, remis en 2017 à la Chancellerie, en parle comme d’un « ensemble d’instruments développés grâce à l’analyse de grandes masses de données de justice qui proposent, notamment à partir d’un calcul de probabilités, de prévoir autant qu’il est possible l’issue d’un litige » (v. Dalloz actualité, 10 janv. 2017, art. M. Babonneau et T. Coustet isset(node/188535) ? node/188535 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188535). C’est vrai que ses atouts donnent le vertige : évaluer les chances de succès d’un contentieux, réduire l’irréductible aléa judiciaire, calculer le montant des indemnités, identifier les bons arguments et inversement, limiter le risque d’une procédure, anticiper son coût et aussi ses effets et même désengorger les tribunaux. Un Graal pour l’avocat, le justiciable, l’assureur, ou même l’État.
On comprend dès lors que certaines legaltech ont choisi de se placer sur le service d’aide à la décision. C’est d’ailleurs le plus prisé. 73 % des juristes pensent le sujet prioritaire, devant les chatbots (63 %) ou la blockchain (59 %), d’après l’étude Digitalisation des directions juridiques, menée par Day One, le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats et le Cercle Montesquieu en février 2019. Qu’est-ce qui se cache derrière cette bannière très à la mode ?
Predictice
Au nombre des poids lourds de ce marché figure Predictice. Orange, Allianz, Axa, et des cabinets d’avocats se sont emparés de ses solutions. La start-up a été créée en 2016 par des juristes et des spécialistes du numérique. La société compte aujourd’hui dix-huit salariés.
Dans des locaux à l’ambiance start-up au mur d’entrée végétalisé et espaces partagés, Louis Larret-Chahine, avocat de formation et cofondateur de Predictice, veut convaincre. Il reçoit en basket et avec le sourire. « Une belle histoire », reconnaît son cofondateur. Tout est parti d’une prise de conscience. « L’explosion de l’information », observe-t-il. « En 2016, quand on tapait "licenciement pour faute", il y avait déjà des dizaines de milliers de décisions qui sortaient », se souvient le start-upeur. « En cabinet, j’ai des souvenirs très clairs d’avoir passé la moitié de la nuit à cliquer sur des décisions de justice et voir si oui ou non elles étaient pertinentes pour le cas à défendre ». Ce travail, Predictice propose de le faire à la place du praticien, et en mieux.
L’ancien avocat veut bien en faire la démonstration. La « grande spécialité » de la société, explique-t-il, c’est « le traitement automatique du langage ». L’algorithme développé par leurs techniciens est censé comprendre le sens réel des décisions. « On a mis presque deux ans et 2 millions d’euros d’efforts. On est considéré comme une des meilleures équipes au monde sur ce sujet aujourd’hui », lâche Louis Larret-Chahine. Sa technologie « lit deux millions de documents en intégralité par seconde ».
L’outil propose deux types de prestation. D’un côté, c’est « un moteur de recherche et, de l’autre, un outil d’analytique juridique », avance son fondateur. Traditionnellement, l’utilisateur tape ses mots-clés dans le moteur de recherche. Celui-ci identifie les documents qui contiennent mécaniquement l’occurrence des mots-clés. « Ce qui ne permet pas de tomber sur le bon document », analyse-t-il. Mais l’outil comprendrait ici « ce qui s’est passé dans le document », « l’avocat peut donc s’attendre à avoir toutes les décisions qui vont dans le sens de son affaire ».
« Quand on parle de justice prédictive, c’est purement marketing »
« Ce n’est pas une boule de cristal », prévient Louis Larret-Chahine. Donc, « quand on parle de justice prédictive, c’est purement marketing », reconnaît-il. En gros, l’outil propose des analyses statistiques sur les décisions de justice. Selon la recherche de l’utilisateur et sur un ensemble de décisions de justice, le logiciel promet de calculer le taux de succès en fonction de la juridiction souhaitée, le montant de l’indemnité, la base légale jugée la plus efficace, la durée moyenne de la procédure dans le ressort, le taux d’affaires gagnées par tel avocat, etc.
Concrètement, l’avocat souhaite avoir toutes les décisions pertinentes qui acceptent ou rejettent sa demande en nullité du licenciement par exemple. Parmi quatre-vingts filtres sur lesquels s’opère le tri, il y en a un « vraiment spécifique », vante le cofondateur, qui porte sur le dispositif. « On est à 96 % de fiabilité », avance-t-il. « L’outil lit alors les décisions en temps réel et trouve 248 décisions qui ont effectivement accepté la demande. » Résultat à affiner en fonction d’autres filtres, comme le ressort, la date, le sens de la décision, etc. Le tri peut se faire sur près de quatre-vingts critères, comme le fait que des profils similaires aient ou non apprécié les documents.
En 2017, Xavier Ronsin, premier président de la cour d’appel de Rennes, avait jugé à l’époque que ce logiciel « n’apportait aucune plus-value par rapport à d’autres moteurs de recherche » (v. Dalloz actualité, interview de X. Ronsin, 16 oct. 2017, par T. Coustet). Il lui reprochait justement de ne s’intéresser qu’au dispositif d’une décision de justice. « Par exemple, en appel, le dispositif peut très bien confirmer une partie de la décision des premiers juges et le logiciel ne saura pas dire quels éléments sont confirmés et de quelle manière », avait-il observé (Dalloz actualité, interview préc.). « Xavier Ronsin n’a eu l’outil en main que quelques minutes, très tôt, et à une époque où le logiciel n’était même pas commercialisé », balaie Louis Larret-Chahine. Pour lui, le test mené à l’époque s’est surtout heurté à une « résistance idéologique ».
Case Law Analytics
De son côté, Case Law Analytics est une autre start-up qui surfe sur le marché de l’aide à la décision. Allianz, Axa, SNCF Réseau, Yves Rocher et près de mille avocats comptent parmi ses clients. Pourtant, son fondateur, Jacques Lévy Véhel, polytechnicien et ancien directeur de recherche à l’INRIA Bretagne Atlantique, se garde bien de se positionner sur le créneau de la justice prédictive. Il s’en défend même. Son produit « ne délivre pas à l’utilisateur la décision de justice la plus probable », assure ce mathématicien de formation. L’outil propose sobrement à l’utilisateur de « visualiser l’aléa judiciaire grâce à des outils mathématiques et des données chiffrées ».
Jacques Lévy Véhel sort en septembre 2017, avec Jérôme Dupré, docteur en droit, ancien avocat et magistrat, sa technologie après quatre ans de recherche. Des modèles mathématiques et informatiques spécialement développés par l’équipe et qui relèvent de l’intelligence artificielle. « Comme cela existe d’ailleurs dans d’autres domaines, en médecine, par exemple », observe-t-il. Son entreprise compte aujourd’hui quatorze salariés, dont huit juristes.
« Dans chaque nouveau type de contentieux, nous commençons par aller voir des praticiens, des juges et des avocats. Nous déterminons avec eux la liste de critères pris en compte pour la décision. Leur nombre se situe en général entre 30 et 150 critères. Dans un deuxième temps, nous analysons la jurisprudence et nous construisons une base de données de décisions de justice. Une quantité variable, qui peut aller jusqu’à des centaines de milliers. Nous utilisons bien sûr des outils de traitement du langage naturel, pour retrouver automatiquement les valeurs de chaque critère, mais une partie de ce travail est effectuée manuellement par des humains. En effet, tous les critères ne sont pas disponibles dans les décisions, comme la conjoncture économique ou la concentration du secteur en matière de rupture brutale, par exemple. Enfin, dans une troisième étape, nous utilisons l’intelligence artificielle pour modéliser le processus de décision judiciaire et présenter l’éventail des décisions qui pourraient être prises par une cour sur un dossier donné. Restituer une pluralité de solutions est essentiel d’un point de vue éthique et est rendu possible grâce à une technologie que nous sommes les seuls à maîtriser », observe-t-il.
En fin de chaîne, l’outil permet de « visualiser le risque judiciaire » valable dans quinze domaines à fort contentieux, de la rupture brutale des relations commerciales, au droit du travail (licenciement sans cause réelle ou sérieuse). Le logiciel présente à l’utilisateur les décisions que prendraient cent juges virtuels, selon les critères définis à l’avance. Le client peut donc savoir si une majorité de ces juges virtuels lui donnerait tort ou raison, lui attribuerait une indemnité, avec un montant visualisable sur un histogramme, et quels sont les arguments qui ont emporté l’adhésion ou inversement.
« On ne peut pas aujourd’hui faire l’économie de l’intervention humaine »
« On ne peut pas aujourd’hui faire l’économie de l’intervention humaine », analyse ce polytechnicien. Un message rassurant. Le monde de la justice reste en effet tiraillé entre sa nécessaire adaptation aux évolutions numériques et le souci de préserver une proximité avec le citoyen. Ces avancées technologiques présenteraient pour l’un l’assurance d’une justice plus rapide et plus sûre parce que libérée de tous ses biais subjectifs. Pour l’autre, elles seraient tout bonnement l’incarnation d’une justice mécanique où le juge serait réduit à l’état d’automate. Ce qu’Antoine Garapon appelait le « risque d’annexion », qui transformerait le juriste en « auxiliaire de stratégie économique » qui mettrait sur le même plan le droit avec d’autres données comme le tempérament d’un juge par exemple (v. Dalloz actualité, 4 mai 2018, interview d’A. Garapon, par T. Coustet).
L’open data, le nerf de la guerre
On comprend dès lors que l’accès à la jurisprudence soit une donnée précieuse. Le libre accès à l’intégralité des décisions de justice est attendu de pied ferme par ces nouveaux opérateurs. Aujourd’hui, entre 150 000 et 200 000 décisions de justice par an sont disponibles dans les bases de données des éditeurs juridiques. Les services du greffe ont d’ailleurs l’obligation de délivrer copie de toute décision judiciaire publique à tous requérants français ou étrangers en veillant à leur anonymisation. Deux cours d’appel ont statué en ce sens en faveur de la legaltech Doctrine (Paris, 18 déc. 2018, n° 17/22211, et Douai, 21 janv. 2019, n° 18/06657, Dalloz actualité, 20 fév. 2019, obs. A. Bloze isset(node/194568) ? node/194568 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194568). Encore faut-il en faire la demande.
Dès que l’on pourra massifier l’accès aux jugements des tribunaux de grande instance (environ 950 000 par 2017), d’instance (640 000) et à ceux des tribunaux de commerce (150 000 à 200 000), l’open data judiciaire changera d’échelle. Et les logiciels qui vont avec, également.
Sa mise en œuvre tarde à voir le jour. La loi Lemaire de 2016 rend obligatoire la diffusion et la loi Justice de mars 2019 confie son déploiement à la Cour de cassation. « La bonne marche du projet se heurte à des résistances psychologiques », confie un proche de la Chancellerie qui se montre de plus en plus pessimiste sur une mise en œuvre rapide.
Le 20 mars dernier, le Conseil national des barreaux a élaboré une « déclaration commune » avec la Cour de cassation pour la création « d’une autorité de régulation constituée pour l’exploitation des bases de données de jurisprudence » (v. Dalloz actualité, 20 mars 2019, art. T. Coustet isset(node/194998) ? node/194998 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194998).
Ce chantier n’a pourtant aucune valeur contraignante. La Chancellerie est en plus hostile à toute régulation qui viendrait de l’État. Elle s’est d’ailleurs opposée à une procédure de certification souhaitée par le CNB en ce qui concerne les plateformes numériques de résolution amiable (v. Dalloz actualité, 13 juill. 2018, art. T. Coustet isset(node/191614) ? node/191614 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191614). Et c’est le même son de cloche pour l’open data : « il ne nous semble pas nécessaire ni forcément opportun d’instituer pour ce faire un organisme spécifique dont le fonctionnement purement administratif ne répondra pas nécessairement aux exigences de réactivité d’un marché jeune et très dynamique », justifie le ministère de la justice.
Justice robot en Estonie
On n’est pourtant pas très loin de la justice robot. Pas en France, mais en Estonie. À 2 150 km de l’Hexagone, le ministère de la justice local envisage de recourir à l’intelligence artificielle pour trancher des litiges « de moins de 7 000 € ». La condition ? « Toujours sous la supervision d’un humain », promet l’Estonie.
En gros, les deux parties concernées par des litiges renseigneraient leurs documents, arguments et preuves sur une plateforme pour nourrir l’intelligence artificielle. Selon Wired, le projet devrait voir le jour cette année. Ce serait une première mondiale. Ceci explique peut-être cela.
Sur le même thème
-
Clause de dessaisissement au sein d’une convention d’honoraires d’avocat et lutte contre les clauses abusives
-
De l’étendue du devoir de conseil de l’expert-comptable
-
La plaidoirie est-elle un art noble ?
-
Droit de se taire du notaire poursuivi disciplinairement : la loi muette à ce sujet reste conforme à la Constitution
-
Pôles « violences intrafamiliales » : présentation de la circulaire
-
Le bâtonnier est-il compétent pour statuer sur la dissolution d’une société civile immobilière entre deux avocats ?
-
Le droit à la preuve vient-il d’achever le secret professionnel de l’avocat ?
-
Violences intrafamiliales : institution de pôles spécialisés au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel
-
Loi organique n° 2023-1058 sur l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire
-
Le notaire et le droit au silence dans le cadre d’une procédure disciplinaire




