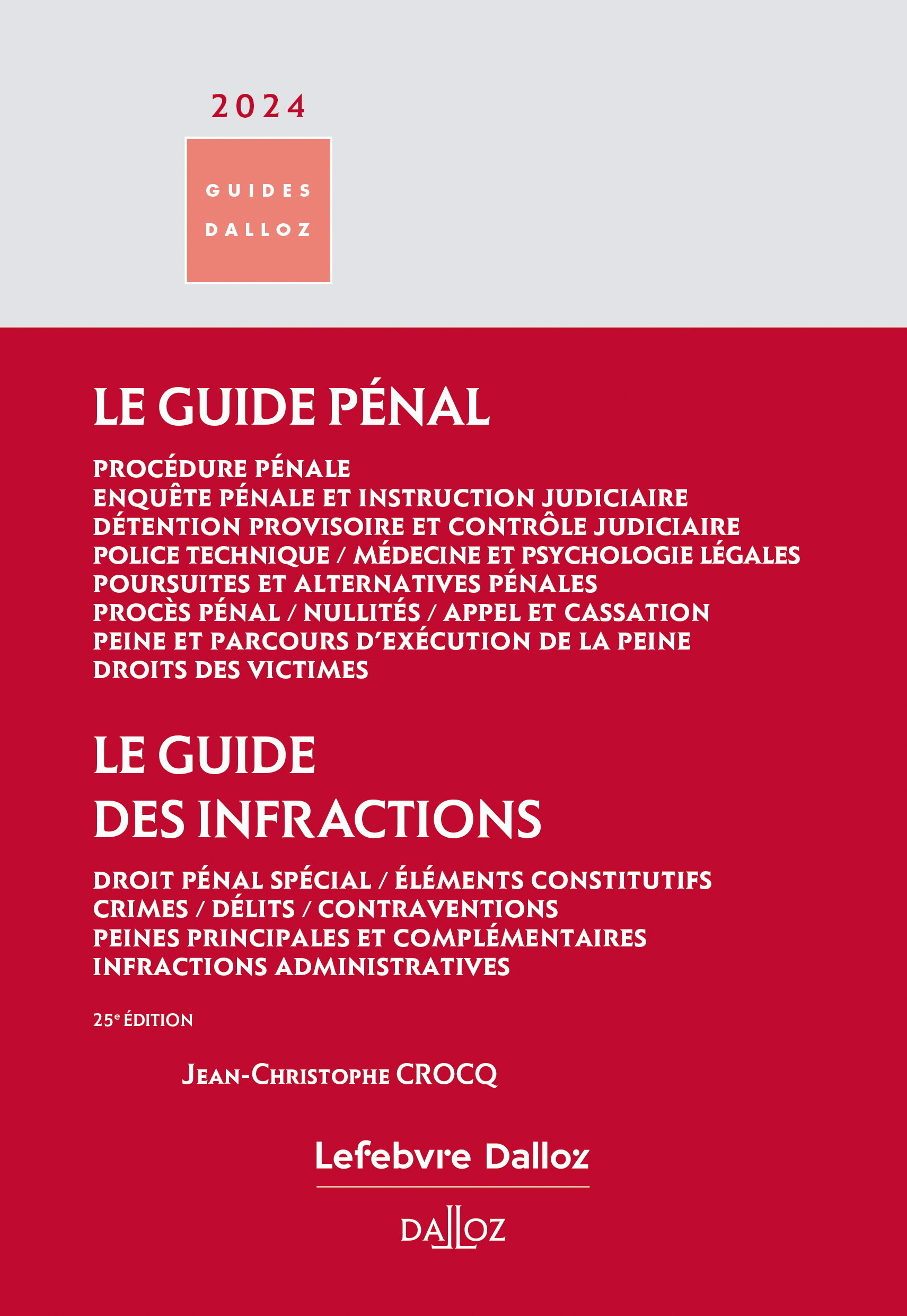- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
CEDH : la condamnation pour un courriel dénonçant une agression sexuelle est contraire à la Convention
CEDH : la condamnation pour un courriel dénonçant une agression sexuelle est contraire à la Convention
Soulignant la nécessité d’apporter une protection appropriée aux personnes dénonçant les faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes, la Cour européenne considère qu’en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce les critères de la bonne foi, les juridictions françaises ont porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de la Nouvelle-Calédoniele 30 janvier 2024

Le 7 juin 2016, la requérante envoyait, depuis son adresse électronique personnelle, un courriel intitulé « Agression sexuelle, Harcèlement sexuel et moral », à destination du directeur général de l’association dans laquelle elle travaillait, en plaçant en copie l’inspecteur du travail, son propre époux, l’auteur allégué des faits ainsi que deux de ses fils, dont l’un travaillait également dans l’association. Dans son message, la requérante se disait victime des infractions visées en objet et demandait à son employeur à être dispensée d’activité dans l’attente de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 24 juin, son époux publiait sur Facebook un billet reprenant les allégations de la requérante qualifiées de « scandale sexuel » et citant le patronyme de l’agresseur présumé et le nom de l’association. Le 1er août suivant, la requérante et son époux étaient cités devant le tribunal correctionnel pour répondre de diffamation publique.
Le 16 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de Paris retenait la culpabilité de la requérante et de son époux, la première contestant pourtant le caractère public des propos diffamatoires au motif qu’elle avait adressé son courriel à des personnes liées par une communauté d’intérêt et estimant qu’elle devait bénéficier de l’excuse de bonne foi. Le 21 novembre 2018, la Cour d’appel de Paris confirmait le jugement sur le fond, réduisant la peine d’amende infligée à la requérante à 500 € avec sursis. Enfin, par arrêt du 26 novembre 2019, la Cour de cassation rejetait le pourvoi de la requérante, retenant que « la cour d’appel a[vait] déduit, à juste titre, que Mme Allée ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante » (Crim. 26 nov. 2019, n° 19-80.360, Dalloz actualité, 18 déc. 2019, obs. S. Lavric ; D. 2019. 2302 ![]() ; ibid. 2020. 567, chron. A.-L. Méano, L. Ascensi, A.-S. de Lamarzelle, M. Fouquet et C. Carbonaro
; ibid. 2020. 567, chron. A.-L. Méano, L. Ascensi, A.-S. de Lamarzelle, M. Fouquet et C. Carbonaro ![]() ; AJ pénal 2020. 130, obs. J. Lasserre Capdeville
; AJ pénal 2020. 130, obs. J. Lasserre Capdeville ![]() ; Dr. soc. 2020. 550, chron. R. Salomon
; Dr. soc. 2020. 550, chron. R. Salomon ![]() ; Légipresse 2019. 667 et les obs.
; Légipresse 2019. 667 et les obs. ![]() ; ibid. 2020. 108, étude C. Mas
; ibid. 2020. 108, étude C. Mas ![]() ; ibid. 193, étude N. Verly
; ibid. 193, étude N. Verly ![]() ; ibid. 322, étude N. Mallet-Poujol
; ibid. 322, étude N. Mallet-Poujol ![]() ; RSC 2020. 77, obs. Y. Mayaud
; RSC 2020. 77, obs. Y. Mayaud ![]() ; Gaz. Pal. 4 févr. 2020. 55, obs. S. Detraz), et refusant également l’application du fait justificatif d’autorisation de la loi (C. pén., art. 122-4) tiré de l’application des articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail concernant la dénonciation de faits de harcèlement moral ou sexuel auprès de son employeur.
; Gaz. Pal. 4 févr. 2020. 55, obs. S. Detraz), et refusant également l’application du fait justificatif d’autorisation de la loi (C. pén., art. 122-4) tiré de l’application des articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail concernant la dénonciation de faits de harcèlement moral ou sexuel auprès de son employeur.
C’est dans ce contexte que Mme Allée saisissait la Cour européenne d’une requête fondée sur la méconnaissance de l’article 10 de la Convention, estimant que sa condamnation pénale pour diffamation avait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression. Par son arrêt, la Cour européenne conclut en effet, au terme de l’examen de la mise en balance entre liberté d’expression et protection de la réputation, à la violation de l’article 10, en retenant « l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d’expression et le but poursuivi » (§ 55). Pour ce faire, elle retient en particulier que les juridictions nationales ont fait une application trop restrictive des critères de la bonne foi.
L’examen de la mise en balance entre liberté d’expression et protection de la réputation
À l’appui de sa demande, la requérante faisait principalement valoir le style plutôt mesuré de son courriel, dans pareil contexte – celui de la dénonciation d’actes graves –, et l’absence de répercussion sur la réputation de l’auteur allégué des faits dénoncés. De son côté, le gouvernement français soutenait que la condamnation de la requérante était intervenue dans le strict cadre de l’article 10 de la Convention : conformément à la loi, pour protéger un but légitime, apparaissant comme nécessaire et proportionnée.
Il appartenait donc à la Cour européenne d’apprécier la proportionnalité de l’ingérence subie par la requérante, en suivant les critères de légitimation posés par le § 2 de l’article 10 de la Convention (légalité, but légitime poursuivi, proportionnalité). La légalité de l’ingérence ne posait guère de difficulté. Dans son arrêt, la Cour précise qu’elle n’entend pas remettre en question la manière dont les juridictions internes ont appliqué le droit français, à savoir la loi sur la presse concernant la qualification de diffamation publique et l’excuse de bonne foi, et les dispositions du code du travail s’agissant de l’immunité pouvant bénéficier au salarié dénonçant des faits de harcèlement ; elle conclut ainsi que l’ingérence était bien « prévue par la loi » (§ 43). Le but...
Sur le même thème
-
Une association de femmes amène la CEDH à se prononcer sur l’urgence climatique
-
Petite pause printanière
-
Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I bis et les règles de compétence issues d’une convention internationale
-
Éclaircissements sur l’interdiction d’un service de mise en relation entre pharmaciens et clients pour le commerce électronique de médicaments non soumis à prescription médicale
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Ubérisation de la pharmacie : la Cour de justice précise les conditions de licéité des plateformes de vente en ligne de médicaments
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
L’AI Act dans sa version finale – provisoire –, une hydre à trois têtes
-
Forum delicti et fraude aux gaz d’échappement : des précisions sur le lieu de matérialisation du dommage
-
Une conversion après avoir quitté son pays d’origine ne rend pas la demande d’asile abusive
Sur la boutique Dalloz
Le guide pénal - Le guide des infractions 2024
11/2023 -
25e édition
Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq