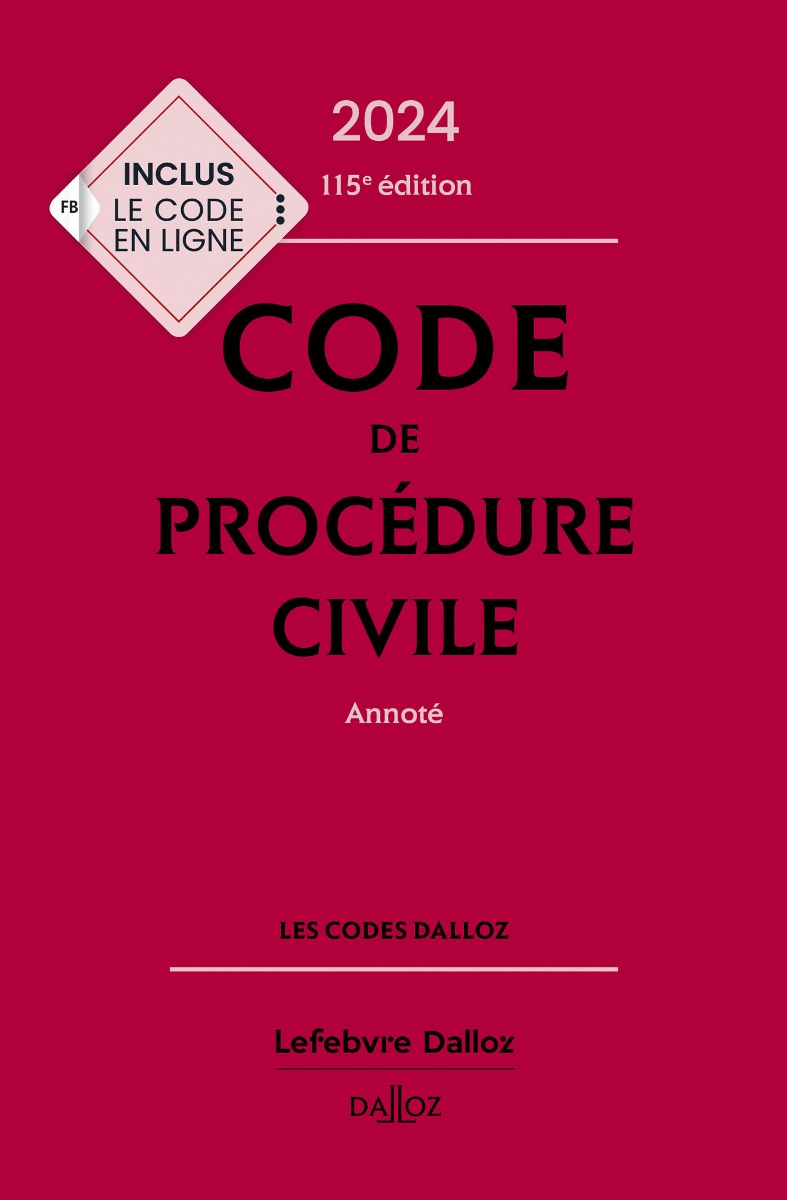- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Chronique d’arbitrage : effet utile v. volonté des parties
Chronique d’arbitrage : effet utile v. volonté des parties
La Cour d’appel de Paris a consacré il y a quelques mois un principe d’effet utile de la convention d’arbitrage. Pourtant, en parallèle, elle adopte une lecture toujours plus stricte de la volonté des parties, privilégiant la volonté exprimée sur la volonté implicite, allant jusqu’à priver la clause de tout effet. Voilà une tendance qui interroge.
par Jérémy Jourdan-Marques, Professeur à l'Université Lumière Lyon 2le 11 septembre 2023

Par ces solutions, la cour d’appel semble suivre des logiques contraires. L’effet utile ne doit-il pas permettre d’aller au-delà de la volonté des parties ? C’est en tout cas la question que l’on peut se poser à la lecture des arrêts Sultan de Sulu (Paris, 6 juin 2023, n° 21/21386, JCP 2023. 829, obs. D. Mainguy) et MCB (Paris, 13 juin 2023, n° 21/07296). Il convient de faire le point sur les interactions entre la nécessaire identification de la volonté des parties de recourir à l’arbitrage et le tout aussi nécessaire principe d’effet utile de la convention d’arbitrage.
Par-delà cette problématique, la période récente est marquée par de nombreuses décisions intéressantes. On citera les arrêts CNAN (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 21-24.968, D. 2023. 1125 ![]() ) et Trasta (Paris, 23 mai 2023, n° 22/05378) sur l’obligation de révélation, l’arrêt Lucas sur l’obtention de l’exequatur (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-12.757, D. 2023. 1125
) et Trasta (Paris, 23 mai 2023, n° 22/05378) sur l’obligation de révélation, l’arrêt Lucas sur l’obtention de l’exequatur (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-12.757, D. 2023. 1125 ![]() ), le très riche arrêt Imagine (Paris, 16 mai 2023, n° 21/21189) et l’importantissime arrêt Prosper River sur la notification des sentences avant l’exécution forcée (Paris, 8 juin 2023, n° 22/12481). Enfin, à titre au moins symbolique, il convient de mentionner l’arrêt Semenya de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 11 juill. 2023, n° 10934/21, D. 2023. 1360, et les obs.
), le très riche arrêt Imagine (Paris, 16 mai 2023, n° 21/21189) et l’importantissime arrêt Prosper River sur la notification des sentences avant l’exécution forcée (Paris, 8 juin 2023, n° 22/12481). Enfin, à titre au moins symbolique, il convient de mentionner l’arrêt Semenya de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 11 juill. 2023, n° 10934/21, D. 2023. 1360, et les obs. ![]() ).
).
Effet utile v. volonté des parties
Le principe de l’effet utile de la convention d’arbitrage a fait l’objet d’une consécration explicite par la Cour d’appel de Paris il y a peu de temps (Paris, 4 avr. 2023, n° 22/07777, BZ Grains, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques et Paris, 4 avr. 2023, n° 22/00408, Jan de Nul, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; v. égal., Paris, 16 mai 2023, n° 21/21189, Imagine). Inspiré, semble-t-il, pas une décision du Tribunal de commerce de Bayonne du 25 mars 2013 (n° 2012001302), il permet à la cour de « rechercher la commune volonté des parties à la lumière […] du principe d’effet utile, selon lequel lorsque les parties insèrent une clause d’arbitrage dans leur contrat, il y a lieu de présumer que leur intention a été d’établir un mécanisme efficace pour le règlement des litiges visés par la clause compromissoire ».
L’idée d’un effet utile appelé au secours de l’arbitrage n’est pas nouvelle. On la retrouve déjà il y a dix ans sous la plume de la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 mars 2013, n° 12-20.573, Dalloz actualité, 25 mars 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 780 ![]() ; ibid. 2936, obs. T. Clay
; ibid. 2936, obs. T. Clay ![]() ; RTD civ. 2013. 631, obs. P.-Y. Gautier
; RTD civ. 2013. 631, obs. P.-Y. Gautier ![]() ; JCP 2013. 465, note D. Mouralis ; Procédures 2013. Comm. 150, obs. L. Weiller). On a encore pu l’apercevoir plus récemment, tant sur des questions de compétence (Paris, 20 oct. 2020, n° 18/07943, RTD com. 2022. 471, obs. E. Loquin
; JCP 2013. 465, note D. Mouralis ; Procédures 2013. Comm. 150, obs. L. Weiller). On a encore pu l’apercevoir plus récemment, tant sur des questions de compétence (Paris, 20 oct. 2020, n° 18/07943, RTD com. 2022. 471, obs. E. Loquin ![]() ; Rev. arb. 2021. 187, note P. Cavalieros ; 5 déc. 2017, n° 15/24961, Accor Afrique, Rev. arb. 2018. 624, note J. Barbet) que sur l’interprétation des règlements d’arbitrage (Paris, 26 janv. 2021, n° 19/10666, Dalloz actualité, 22 févr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; JCP 2021. 696, obs. P. Giraud).
; Rev. arb. 2021. 187, note P. Cavalieros ; 5 déc. 2017, n° 15/24961, Accor Afrique, Rev. arb. 2018. 624, note J. Barbet) que sur l’interprétation des règlements d’arbitrage (Paris, 26 janv. 2021, n° 19/10666, Dalloz actualité, 22 févr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; JCP 2021. 696, obs. P. Giraud).
Nous avons déjà pu qualifier ce principe d’effet utile de « sous-règle matérielle » (J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : variations autour de la compétence, Dalloz actualité, 30 mai 2023). Concrètement, l’arrêt Dalico fixe une règle matérielle principale, laquelle impose de rechercher la volonté des parties (Civ. 1re, 20 déc. 1993, n° 91-16.828, Rev. crit. DIP 1994. 663, note P. Mayer ![]() ; RTD com. 1994. 254, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin
; RTD com. 1994. 254, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin ![]() ; Rev. arb. 1994. 116, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1994. 432, note E. Gaillard ; v. à ce sujet, J. Jourdan-Marques, Faut-il consolider Dalico ? Réflexion sur les règles matérielles relatives à la compétence arbitrale, Rev. arb. 2021. 1049). Reste que cette volonté peut être exprimée de manière maladroite, imprécise, voire contradictoire. C’est là que l’effet utile intervient. En sa qualité de sous-règle matérielle, il sert à éclairer la volonté des parties qui, selon ce principe, n’ont pas pu vouloir une convention privée de tout effet.
; Rev. arb. 1994. 116, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1994. 432, note E. Gaillard ; v. à ce sujet, J. Jourdan-Marques, Faut-il consolider Dalico ? Réflexion sur les règles matérielles relatives à la compétence arbitrale, Rev. arb. 2021. 1049). Reste que cette volonté peut être exprimée de manière maladroite, imprécise, voire contradictoire. C’est là que l’effet utile intervient. En sa qualité de sous-règle matérielle, il sert à éclairer la volonté des parties qui, selon ce principe, n’ont pas pu vouloir une convention privée de tout effet.
Ainsi, en apparence, il ne peut y avoir de contradiction entre la recherche de la volonté des parties et le principe d’effet utile, en particulier en ce que le second n’est utilisé que pour combler les incertitudes de la première. À ce titre, l’effet utile ne doit pas pouvoir entrer en conflit avec la volonté des parties et prétendre être « calife à la place du calife », son asservissement étant un élément constitutif de son rôle. C’est d’ailleurs cette logique que semble suivre la Cour d’appel de Paris dans ses arrêts Sultan de Sulu (Paris, 6 juin 2023, n° 21/21386, préc. ; JCP 2023. 829, obs. D. Mainguy) et MCB (Paris, 13 juin 2023, n° 21/07296, préc.). Comment, dès lors, lui en tenir rigueur ? Assez paradoxalement, en constatant que le rôle donné à la volonté des parties par la jurisprudence récente est disproportionné.
Au vrai, on peut dire que, depuis plusieurs décennies, le droit français est « opportuniste ». S’il porte la volonté des parties au pinacle, c’est dans le but, tantôt avoué tantôt caché, de soutenir l’efficacité de l’arbitrage. À ce titre, la volonté des parties n’est pas seulement celle exprimée ; elle est encore celle qui est implicite, parce que les arbitres et la jurisprudence, qui lisent dans le marc de café, ont su l’identifier. Il y a ainsi un dessein secret au droit de l’arbitrage, qui justifie une vision dynamique de la volonté des parties.
Force est de constater que la jurisprudence récente marque, sur ce point, une forme de coup d’arrêt (v. égal., Paris, 6 déc. 2022, n° 21/11615, Eckes, Dalloz actualité, 14 mars 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; Gaz. Pal. 2023, n° 16, obs. L. Larribère ; en revanche, de façon beaucoup plus satisfaisante, Paris, 4 avr. 2023, n° 22/07777, BZ Grains, préc. et Paris, 4 avr. 2023, n° 22/00408, Jan de Nul, préc.). Il est d’autant plus marquant qu’il est plus ou moins concomitant avec la consécration explicite du principe d’effet utile. Finalement, ce dernier semble avoir été consacré pour mieux le bâillonner. Examinons successivement les deux solutions, pour se rendre compte comment la recherche de la volonté des parties peut avoir pour conséquence de paralyser l’effet utile.
L’affaire Sultan de Sulu
Rappelons brièvement les faits avant d’en venir à l’examen de la compétence.
Les faits
L’affaire Sultan de Sulu est explosive. Ses enjeux dépassent la sphère juridique et touchent à la sphère diplomatique et économique. La raison est simple : le montant en jeu s’élève à près de 15 milliards de dollars et le litige touche à la souveraineté de la Malaisie.
À l’origine de cette extraordinaire affaire, on trouve un contrat conclu en 1878 entre le Sultan de Sulu de l’époque, Jamalul Alam Kiram (ou Muhammad Jamal Al Alam) et deux personnes privées, M. Alfred Dent et le Baron Gustavus Von Overbeck. Par ce contrat, le premier cédait aux seconds un certain nombre de droits et obligations sur ses territoires de Bornéo du Nord en contrepartie d’une certaine somme d’argent. Naturellement, les parties au contrat sont aujourd’hui décédées. Pour le Sultan de Sulu, huit citoyens philippins se présentent comme ses successeurs. Pour Alfred Dent et le Baron Gustavus Von Overbeck, la Malaisie a succédé aux droits dans ce contrat à la suite de son indépendance.
Pendant des décennies, la Malaisie a continué à verser la somme fixée par le contrat aux héritiers. En 2013, un autoproclamé Sultan de Sulu a tenté d’envahir militairement le Sabah – actuel État de la Malaisie à Bornéo Nord – avec pour objectif de reprendre ce territoire. Depuis, la Malaisie a cessé de payer le prix prévu par l’accord.
Ainsi, les huit citoyens philippins reprochent à la Malaisie de ne plus exécuter l’accord de 1878.
Au fond, l’imbroglio juridique et diplomatique porte sur la nature de l’accord. Pour les huit citoyens philippins, il s’agit d’un « banal » contrat commercial. Pour eux, la cessation des paiements par la Malaisie équivaut à une inexécution contractuelle dont ils peuvent demander réparation. Pour la Malaisie en revanche, l’accord de 1878 était un accord de cession de territoires et de souveraineté. Ce problème de qualification est doublé d’un problème linguistique. Le contrat a été rédigé en malais en écriture jawi (alphabet arabe alors utilisé pour l’écriture du malais), ce qui rend sa compréhension délicate.
Comment résoudre le litige ? Le contrat comporte une clause – qui fait l’objet de traductions divergentes – mais qui prévoit que les « différends résultant de l’accord seront tranchés par le Consul général de Bornéo ».
Sur le fondement de cette clause, les huit citoyens philippins ont tenté d’obtenir la désignation d’un arbitre. Puisque le poste de Consul Général britannique à Bornéo n’existe plus, ils se sont d’abord tournés vers le ministère des Affaires étrangères britannique. Face au refus de désignation, ils ont opté pour les juridictions espagnoles, qui, malgré le défaut de comparution de la Malaisie, ont fait droit à leur demande et ont désigné l’arbitre.
Fort de cette désignation d’un arbitre unique, la procédure arbitrale a pu commencer. Là encore, la Malaisie n’a pas formellement comparu, même s’il elle a adressé quelques courriers de contestation à l’arbitre. Le 25 mai 2020, l’arbitre a rendu une sentence partielle sur la compétence. C’est cette sentence qui est aujourd’hui déférée à la Cour d’appel de Paris, à la suite d’un appel contre l’ordonnance d’exequatur (pour le reste des faits dans cette affaire rocambolesque, v. J. Bouissou, Entre la Malaisie et les descendants d’un sultan de Bornéo, un litige rocambolesque à 15 milliards de dollars, Le Monde, 1er juin 2023 et la note de D. Mainguy).
L’examen de la compétence
La difficulté au cœur de l’arrêt résulte de la rédaction de la convention d’arbitrage, dont les multiples et incertaines traductions rendent l’exercice d’interprétation délicat. Une chose est sûre : le mot arbitrage n’est jamais utilisé. Une autre l’est : la clause mentionne le « consul général de Bornéo ». Il faut donc s’interroger sur la volonté des parties pour interpréter cette clause.
Après avoir repris les solutions des arrêts Plateau des Pyramides (Paris, 12 juill. 1984, Égypte c/ SPP, Rev. arb. 1986. 75 ; JDI 1985. 129, note B. Goldman ; Civ. 1re, 6 janv. 1987, SPP c/ Égypte, Rev. arb. 1987. 469, note P. Leboulanger ; JDI 1987. 638, note B. Goldman) et Abela (Civ. 1re, 6 oct. 2010, n° 08-20.563, Dalloz actualité, 18 oct. 2010, obs. X. Delpech ; D. 2010. 2441, obs. X. Delpech ![]() ; ibid. 2933, obs. T. Clay
; ibid. 2933, obs. T. Clay ![]() ; Rev. crit. DIP 2011. 85, note F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2011. 85, note F. Jault-Seseke ![]() ; Rev. arb. 2010. 813, note F.-X. Train ; JCP 2010. 1028, note P. Chevalier ; ibid. 1286, obs. J. Ortscheidt ; Gaz. Pal. 8 févr. 2011. 14, obs. D. Bensaude), la cour ajoute un attendu inspiré de l’arrêt Dalico (Civ. 1re, 20 déc. 1993, n° 91-16.828, préc.) : « En vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, qui seule investit l’arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ». Rien que du classique ? Pas tout à fait. La cour ajoute une incise totalement nouvelle selon laquelle la volonté des parties « seule investit l’arbitre de son pouvoir juridictionnel » (v. depuis, Paris, 4 juill. 2023, n° 21/19249, Sogea-Satom).
; Rev. arb. 2010. 813, note F.-X. Train ; JCP 2010. 1028, note P. Chevalier ; ibid. 1286, obs. J. Ortscheidt ; Gaz. Pal. 8 févr. 2011. 14, obs. D. Bensaude), la cour ajoute un attendu inspiré de l’arrêt Dalico (Civ. 1re, 20 déc. 1993, n° 91-16.828, préc.) : « En vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, qui seule investit l’arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ». Rien que du classique ? Pas tout à fait. La cour ajoute une incise totalement nouvelle selon laquelle la volonté des parties « seule investit l’arbitre de son pouvoir juridictionnel » (v. depuis, Paris, 4 juill. 2023, n° 21/19249, Sogea-Satom).
La formule paraît frappée du coin du bon sens. Oui, l’arbitrage est un mode de résolution fondé sur la volonté des parties. C’est d’ailleurs ce qui conduit la doctrine à refuser une telle qualification, par exemple, à l’arbitrage du bâtonnier (T. Clay, obs. ss décr. n° 2011-1985, 28 déc. 2011, Dalloz actualité, 4 janv. 2012, obs. C. Fleuriot ; D. 2012. Pan. 2991 ![]() , spéc. p. 2992). Reste que l’on voit déjà poindre la tension autour de la volonté des parties. L’affirmation est en effet quelque peu excessive et certaines règles matérielles, notamment celle relative à la transmission, sont loin d’avoir la volonté des parties comme première préoccupation. La cour ajoute toutefois que cette volonté des parties doit être recherchée « à la lumière » du principe d’effet utile, ainsi que du principe d’interprétation de bonne foi.
, spéc. p. 2992). Reste que l’on voit déjà poindre la tension autour de la volonté des parties. L’affirmation est en effet quelque peu excessive et certaines règles matérielles, notamment celle relative à la transmission, sont loin d’avoir la volonté des parties comme première préoccupation. La cour ajoute toutefois que cette volonté des parties doit être recherchée « à la lumière » du principe d’effet utile, ainsi que du principe d’interprétation de bonne foi.
Qu’en est-il, à l’aune de ces principes, du choix des parties ? Malgré l’absence du mot arbitrage, la cour souligne que « les parties ont souhaité désigner un tiers au contrat afin de connaître éventuel litige né de l’accord entre elles ou leurs successeurs ». On trouve les premiers éléments de la notion d’arbitrage : la volonté des parties, le tiers, l’existence d’un différend de nature juridique.
Reste à connaître la mission confiée au tiers. La cour constate la diversité des traductions proposées : le tiers doit-il juger, décider, examiner, rendre un avis ? La cour se laisse convaincre par la traduction historique, qui résulte d’un témoin de l’époque, qui a utilisé le mot « décision ». Elle tranche donc la question en retenant que « la stipulation litigieuse peut être regardée comme une clause compromissoire ». Ainsi, à juste titre, la cour ne se laisse pas impressionner par l’absence de mention du mot arbitrage dans la clause. Ce qui compte, c’est la mission confiée au tiers. Dès lors que l’on entend confier à un tiers la mission de trancher un différend, on fait le choix de l’arbitrage.
Le soin apporté à cet examen, plusieurs paragraphes comparant les différentes traductions et soupesant chaque mot, est pleinement justifié. La cour est fondée à rechercher de façon minutieuse le mode de règlement des différends souhaité par les parties. Sur ce point, le rôle de l’effet utile doit être limité et, à notre estime, l’idée d’un caractère résiduel de l’arbitrage doit être maniée avec prudence (C. Jarrosson, La notion d’arbitrage, préf. B. Oppetit, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 1987, n° 486).
Cependant, l’analyse ne s’arrête pas là. La question suivante est celle du choix des parties de confier la résolution du litige au « consul général de Bornéo ». Des documents historiques permettent d’établir que ce choix n’est pas dû au hasard. Le consul général de l’époque bénéficiait de la confiance de toutes les parties et avait pris part aux négociations. Il y a l’idée d’un arbitre choisi intuitu personae dès la signature de la clause. Pour la cour, « cette désignation apparaît, au vu de ces circonstances, comme indissociable de la volonté de compromettre, avec laquelle elle forme un tout ». Elle en déduit que la disparition de la fonction rend inapplicable la clause, qui est devenue caduque. Partant, il aurait fallu un nouvel accord de volonté des parties pour accueillir le recours à l’arbitrage.
Autrement dit, au regard de l’importance de ce choix dans la volonté de recourir à l’arbitrage, le décès de l’arbitre et l’absence d’accord ultérieur emportent la caducité de la clause. Or une clause caduque conduit à l’incompétence du tribunal arbitral.
Cette analyse n’emporte aucunement la conviction. C’est à ce stade que la tension entre la volonté des parties et l’effet utile apparaît. La cour constate l’existence d’une convention d’arbitrage, mais la prive de tout effet utile par une interprétation discutable et sévère de la volonté des parties.
Discutable, d’abord, car la clause ne vise pas une personne prise nommément (M. William Treacher, consul général de l’époque, qui avait la confiance des parties), mais sa fonction. En somme, l’idée que les parties ont été attachées au choix d’une personne comme arbitre au point d’en faire une condition centrale de leur engagement ne résiste pas à l’analyse de la clause. La volonté des parties caractérisée par la cour n’est pas celle exprimée par la clause, mais celle révélée par des documents historiques extérieurs au contrat. Que serait-il advenu si le litige était survenu du vivant de M. William Treacher, mais après la cessation de ses fonctions de consul général ? Faut-il faire prévaloir la lettre de la clause ou le prétendu esprit de celle-ci ? Quid de l’hypothèse où l’intéressé perd son indépendance ou son impartialité ? Faut-il anéantir la clause à raison de la perte de ces qualités ? En somme, la Cour d’appel de Paris a réécrit la clause, en ignorant que seule une fonction y est visée plutôt qu’une personne.
Sévère, ensuite, car la conséquence de cette interprétation est la caducité de la clause. L’être humain n’étant pas éternel et le contrat étant déjà vieux de plus d’un siècle, il est normal que celui qui avait la confiance des parties à l’époque soit décédé. D’ailleurs, les parties elles-mêmes le sont et leurs ayants droit n’ont plus grand-chose à voir avec les contractants d’origine (à tel point que, d’un côté, un souverain a succédé à des personnes physiques et, de l’autre, des personnes physiques ont succédé à un souverain…). L’idée d’une confiance dans cette personne n’a donc, avec l’écoulement du temps, plus grand sens. Pire, on en vient à créer des clauses de règlement des différends « avec DLC ». Alors que la convention d’arbitrage est supposée survivre à l’anéantissement du contrat, c’est tout l’inverse qui se produit en l’espèce.
La solution était-elle inéluctable ? C’est ici, à nos yeux, que l’effet utile doit intervenir. La caractérisation de la volonté des parties de recourir à l’arbitre constitue un point de bascule. S’il faut à tout prix s’assurer que telle était la volonté initiale, le franchissement de cet obstacle doit conduire à une analyse toute différente. Le constat de l’existence d’une convention d’arbitrage entraîne un changement de perspective dans lequel la recherche d’efficacité doit désormais primer. Or, pas plus le décès de la personne de confiance que la disparition de la fonction de consul général de Bornéo ne constituent des obstacles à la mise en œuvre de l’arbitrage. Il suffit de prévoir un nouveau mode de désignation de l’arbitre. C’est ce qu’ont fait les demandeurs, en saisissant les juridictions espagnoles. Ce n’est ni plus ni moins que ce que prévoit l’article 1505, 4°, du code de procédure civile, qui permet de saisir le juge d’appui français en l’absence de toute volonté commune des parties !
En réalité, sous couvert de respecter la volonté des parties, la solution de la cour d’appel a pour effet paradoxal de la priver de toute portée. Il y a une forme de « tout ou rien » dans le raisonnement suivi. C’est une volonté pure et parfaite des parties qui doit pouvoir être respectée, faute de quoi la convention d’arbitrage est privée de tout effet. Tout à l’inverse, il nous semble qu’il convient de hiérarchiser. La volonté de recourir à l’arbitrage est principale. La volonté d’un arbitrage selon certaines modalités est accessoire. L’impossibilité de mettre en œuvre les modalités accessoires ne doit pas emporter la volonté principale. À suivre cette logique, toute maladresse de rédaction est susceptible d’emporter l’édifice. L’effet utile est là pour préserver l’essentiel : la volonté de recourir à l’arbitre. On voit ainsi comment la volonté des parties peut se retourner contre un choix manifeste de recourir à l’arbitrage.
L’affaire MCB
L’arrêt MCB offre une perspective très différente, mais révèle des difficultés analogues (Paris, 13 juin 2023, n° 21/07296, préc.).
Les faits sont importants. En allant à l’essentiel, deux contrats sont conclus (que nous appellerons 1 et 2). Une partie (que nous appellerons A) est identique aux deux contrats, l’autre change (que nous appellerons B pour le contrat 1 et C pour le contrat 2). Les deux contrats contiennent une clause compromissoire qui, si elles ne sont pas rédigées à l’identique, sont très proches. Après la naissance du différend, A dépose une unique demande d’arbitrage contre B et C, fondée sur les deux contrats. Autrement dit, A forme des demandes contre B sur le fondement des contrats 1 et 2 et des demandes contre C sur le fondement des contrats 1 et 2. Le tribunal arbitral se déclare compétent pour connaître de l’ensemble. C’est sa sentence qui est attaquée.
Devant la Cour d’appel de Paris, deux arguments successifs sont présentés. D’une part, la consolidation des différends dans un arbitrage unique est contestée ; d’autre part, l’extension des clauses à des non-signataires est discutée.
Pour trancher la difficulté, la cour d’appel commence là aussi par rappeler les principes. D’abord, la règle de l’arrêt Dalico, à nouveau dans une version un peu modifiée : « En vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire s’apprécie, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique » (cette formule peut se retrouver dans un arrêt antérieur, Paris, 25 janv. 2022, n° 20/12332, Dalloz actualité, 16 mars 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 2330 ![]() , obs. T. Clay ; Gaz. Pal. 2022, n° 15, obs. L. Larribère). Ensuite, elle reprend les principes d’interprétation de bonne foi et d’effet utile.
, obs. T. Clay ; Gaz. Pal. 2022, n° 15, obs. L. Larribère). Ensuite, elle reprend les principes d’interprétation de bonne foi et d’effet utile.
Le choix est fait d’examiner, dans un premier temps, la question de la consolidation dans un arbitrage unique de l’intégralité du litige. À notre connaissance, cette problématique récurrente de la pratique arbitrale est nouvelle devant les juridictions françaises. On notera simplement un arrêt ayant refusé de procéder à la désignation d’un seul arbitre dans une procédure d’arbitrage unique en présence de plusieurs clauses (Paris, 6 juin 2019, n° 18/27939, Dalloz actualité, 28 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2019. 2435, obs. T. Clay ![]() ; JDI 2020. 809, note K. Mehtiyeva). Aussi, l’intérêt de la décision est immense. Les clés données par la cour d’appel sont nombreuses. C’est un faisceau d’indices qui est retenu pour retenir la consolidation.
; JDI 2020. 809, note K. Mehtiyeva). Aussi, l’intérêt de la décision est immense. Les clés données par la cour d’appel sont nombreuses. C’est un faisceau d’indices qui est retenu pour retenir la consolidation.
Premièrement, la cour commence par souligner que « le fait que les contrats constituent un ensemble contractuel qualifié “d’unique” ou non est inopérant au regard de l’autonomie des clauses compromissoires » et d’ajouter, dans la foulée, qu’« il est toutefois nécessaire de se référer au contexte dans lequel a été lancée la réalisation du Projet ». Ainsi, un ensemble contractuel n’est pas nécessaire, mais le lien entre les différentes opérations est un critère pertinent. Si la logique se conçoit, on tique tout de même sur le fondement retenu : l’autonomie de la clause compromissoire a toujours été conçue au singulier et vis-à-vis du contrat principal ; elle n’a jamais été envisagée – à notre connaissance – comme une autonomie entre plusieurs conventions d’arbitrage. Spontanément, on peut même penser que c’est le défaut d’autonomie qui doit être le principe : la prolifération des clauses d’arbitrage dans une pluralité de contrats ne révèle-t-elle pas une volonté unique de soumettre les litiges à l’arbitrage ? Il y a en tout cas matière à réflexion sur ce point.
Deuxièmement, il convient de rechercher la volonté des parties. Dès l’entame de son raisonnement, elle énonce qu’il convient de « tenir compte de la construction des contrats et des références contenues dans chaque clause compromissoire pour apprécier quelle était l’intention des parties ». La cour identifie des références croisées entre les différents contrats, tant au sein des conventions d’arbitrage que des autres stipulations contractuelles. Surtout, et c’est essentiel, elle constate que les clauses révèlent directement – par des stipulations relatives à la jonction – ou indirectement – par référence au règlement CCI – une volonté des parties de permettre la consolidation des différends dans un arbitrage unique. Elle en conclut qu’« il résulte des clauses rappelées ci-dessus qu’elles contiennent toutes, soit directement, soit par référence, une clause de consolidation ».
La combinaison de ces deux premiers éléments permet à la cour de proposer une première conclusion : « Ces éléments, combinés au contexte rappelé ci-dessus, conduisent la cour à considérer que la volonté des parties était de pouvoir consolider dans un même arbitrage les différends portant sur les accords conclus dans le cadre de la réalisation du Projet, si les conditions de la consolidation étaient remplies ».
Toutefois, la cour ne s’arrête pas là. Troisièmement, elle examine la compatibilité des clauses. Elle juge qu’il « résulte des clauses d’arbitrage contenues à l’article 23 de l’Accord d’Association et à l’article 2.2 du Protocole sur renvoi de l’article 8 de l’Accord-Cadre qu’elles sont parfaitement compatibles, qu’elles prévoient l’application du même règlement d’arbitrage, le même siège de l’arbitrage, le même nombre d’arbitres, la même méthode de constitution du tribunal arbitral, la même langue de procédure et le même droit applicable au fond du litige, les différences mineures alléguées n’étant pas suffisantes pour ôter tout effet utile à de telles dispositions établissant la volonté des parties de permettre la consolidation en un arbitrage unique ». Enfin, s’ajoute un élément, qualifié de surabondant par la cour, sur le pouvoir confié au tribunal arbitral de juger de la consolidation.
En définitive, si la faculté de procéder à une consolidation est admise en l’espèce, elle semble nécessiter la réunion de trois critères : un contexte commun, une volonté exprimée par les clauses et une compatibilité entre elles. Autant dire que ces conditions, si elles sont cumulatives, sont lourdes et paraissent bien plus exigeantes que celles retenues par le Règlement de la CCI.
L’examen porte, dans un second temps, sur l’extension de la clause. La question est cette fois de savoir si la clause du contrat 1 peut être étendue au litige entre A et C et la clause du contrat 2 au litige entre A et B. La cour rappelle le principe : « La clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propre qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter, dès lors qu’il est établi que leur situation contractuelle, leurs activités et les relations habituelles existant entre les parties font présumer qu’elles ont accepté la clause compromissoire dont elles connaissaient l’existence et la portée bien qu’elles n’aient pas été signataires du contrat qui la stipulait » (v. déjà, Paris, 23 nov. 2021, n° 18/22323, Dalloz actualité, 21 janv. 2022, obs. J. Jourdan-Marques).
Cette fois encore, la cour s’intéresse à la volonté des parties exprimée par les clauses. Elle juge que « l’intention des parties à l’Accord d’Association était clairement d’inclure tout tiers qui serait concerné par un différend en lien avec le Projet, et de permettre ainsi l’extension à des tiers de ladite clause compromissoire ». Elle examine ensuite, de façon plus classique, la connaissance de la clause et l’implication des parties dans l’exécution des contrats. Elle conclut à l’extension de l’une et l’autre des clauses aux parties non-signataires.
Aux deux temps du raisonnement, consolidation et extension, la cour d’appel place la recherche de la volonté des parties au cœur de sa motivation. La volonté recherchée est explicite ; le raisonnement laisse entendre que le défaut de volonté exprimée équivaut à une volonté contraire. Cette logique est dangereuse. Elle impose aux parties d’anticiper toutes éventualités en recourant à des clauses bavardes. À l’inverse de cette logique, tout l’intérêt du droit de l’arbitrage est d’aller au-delà de la volonté exprimée. La cour l’exprime d’ailleurs elle-même : « La clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propre qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquée ». Ainsi, l’extension et la consolidation n’ont pas à être explicitement prévues par les parties ; il suffit que rien ne l’interdise. Pour illustrer le propos, prenons l’exemple d’une clause contractuelle qui indiquerait seulement « arbitrage ». Faut-il déduire de cette formulation une volonté des parties d’écarter les règles matérielles de transmission et d’extension ou encore d’interdire la consolidation ? La réponse doit être négative.
En définitive, la jurisprudence récente est en train de créer un problème qui n’existe pas. Ce mode de raisonnement n’est ni vertueux ni protecteur de la volonté des parties. Il ouvre la voie aux contestations et à l’insécurité juridique, là où le droit français de l’arbitrage et l’effet utile visent à garantir l’efficacité.
Le problème est donc très similaire à celui identifié dans l’arrêt Sultan de Sulu, même si le destin des clauses est différent. Une fois que la volonté des parties de recourir à l’arbitrage est acquise avec certitude, son régime doit se déployer dans toute sa force. La recherche de la volonté des parties n’est pas requise au soutien de ce régime ; tout au plus, une volonté exprimée – car il ne s’agit pas de la nier – peut être caractérisée pour y faire échec (par ex. dans le cas de la mise à l’écart des règles matérielles au profit d’une loi nationale pour régir la convention d’arbitrage, comme l’envisage l’arrêt Kout Food,Civ. 1re, 28 sept. 2022, n° 20-20.260, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 157 ![]() , note D. Mainguy
, note D. Mainguy ![]() ; ibid. 2022. 2330, obs. T. Clay
; ibid. 2022. 2330, obs. T. Clay ![]() ; Gaz. Pal. 2022, n° 36, p. 5, obs. L. Larribère ; ibid., n° 36, p. 22, obs. J. Clavel-Thoraval ; Rev. arb. 2022. 1367, note F.-X. Train ; Procédures 2022. Comm. 277, obs. L. Weiller ; JCP 2023. 221, obs. C. Seraglini ; ibid. Doctr. 143, obs. C. Nourissat).
; Gaz. Pal. 2022, n° 36, p. 5, obs. L. Larribère ; ibid., n° 36, p. 22, obs. J. Clavel-Thoraval ; Rev. arb. 2022. 1367, note F.-X. Train ; Procédures 2022. Comm. 277, obs. L. Weiller ; JCP 2023. 221, obs. C. Seraglini ; ibid. Doctr. 143, obs. C. Nourissat).
Au-delà de la discussion sur la volonté des parties, signalons deux éléments supplémentaires à propos de cette décision.
Premièrement, on peut se demander si l’examen, dans un premier temps de la consolidation et, dans un second temps, de l’extension, n’est pas redondant. Est-ce qu’entre consolidation et extension, il ne faut pas choisir ? Si l’un des contrats est dépourvu de clause compromissoire, la question se limite à l’extension. Pourquoi en demander plus, alors que la volonté des parties de recourir à l’arbitrage figure dans l’ensemble des contrats ? On peut l’expliquer face à des clauses compromissoires prévues avec un champ d’application très restrictif. Toutefois, dès lors que les deux clauses sont suffisamment larges – ce qui semble être le cas – pour englober tous les litiges, l’extension est dépourvue d’intérêt.
De façon sous-jacente, on voit poindre une confusion entre la compétence et le fond. Expliquons-le simplement, en reprenant les faits d’espèce : A agit contre B sur le fondement des contrats 1 (qu’ils ont conclu ensemble) et 2 (auquel B est étranger). La seule clause compromissoire figurant dans le contrat 1, si elle est suffisamment large (en particulier avec la formule « tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci »), suffit à donner compétence à l’arbitre pour connaître des deux actions. Reste que, à ce stade, l’action fondée sur le contrat 1 est contractuelle et l’action fondée sur le contrat 2 est extracontractuelle. Le raisonnement est identique pour l’action intentée par A contre C. La clause compromissoire figurant dans le contrat 2, si elle est suffisamment large, fonde la compétence de l’arbitre. L’action fondée sur le contrat 1 reste néanmoins extracontractuelle et celle fondée sur le contrat est bien contractuelle. Ainsi, la consolidation est suffisante. En examinant l’extension, on perçoit que, en creux, c’est la transformation des actions extracontractuelles en actions contractuelles qui est recherchée. Toutefois, cette question relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et repose sur des critères extérieurs au droit de l’arbitrage.
Deuxièmement, on peut se demander si la consolidation est une question de compétence au sens de l’article 1520, 1°, du code de procédure civile. La consolidation est un outil qui se rapproche de la jonction d’instance prévue à l’article 367 du code de procédure civile. Il s’agit d’un mécanisme procédural servant à assurer une bonne administration de la justice en confiant au même tribunal arbitral la résolution de plusieurs litiges. Le préalable à la mise en œuvre de ce mécanisme est la compétence du tribunal arbitral pour connaître de l’un ou l’autre des litiges. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de la recherche de clauses compatibles, faute de quoi la volonté des parties risque d’être violée. Il y a un tribunal arbitral qui est compétent pour connaître de l’un ou de l’autre des litiges, et la question posée est celle de lui confier la connaissance de l’un et de l’autre au sein d’une même procédure. Cette question ne touche donc pas à la compétence, puisque celle du tribunal arbitral ne fait aucun doute. Il s’agit d’un choix procédural qui, comme le prévoit l’article 368 du code de procédure civile pour la procédure étatique, doit être qualifié de mesure d’administration arbitrale.
En définitive, l’arrêt MCB, en ce qu’il préserve la compétence arbitrale, ne pose pas de difficultés. Reste que sa motivation et sa construction sont sujettes à discussions et révèlent une tendance, déjà vue auparavant, à faire primer la volonté exprimée par les parties au détriment de la recherche de l’efficacité de l’arbitrage. Or cette démarche nie l’originalité de la civil law sur la common law. La consécration des principes d’interprétation de bonne foi et d’effet utile vont, à cet égard, dans le bon sens. La motivation des décisions gagnerait à plus insister dessus, plutôt qu’à rechercher une quelconque volonté exprimée dans les trois lignes que constitue une convention d’arbitrage.
Le principe compétence-compétence
On le dit et on le répète depuis des années et les lecteurs de cette chronique le savent, le maniement du principe compétence-compétence est un art délicat. L’observation des décisions d’appel rendue à travers la France révèle les difficultés de compréhension et de mise en œuvre du principe. L’affaire Innova Invest en offre une illustration presque caricaturale. Dans cette affaire, deux pactes d’associés coexistent et seul un d’entre eux contient une clause compromissoire. Trois procédures distinctes ont été intentées devant les juridictions étatiques et ont donné lieu à trois arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Aix-en-Provence, 23 sept. 2021, n° 21/01407, Dalloz actualité, 19 nov.. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; 30 juin 2022, n° 21/18443, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; 11 mai 2023, n° 22/10750). Nous avions eu l’occasion de critiquer les deux premiers. Dans le premier arrêt, la cour a considéré que l’action intentée devant le juge étatique relevait du pacte dépourvu de convention d’arbitrage, ce qui lui a permis de retenir sa compétence. Dans le second, la cour a joué d’une distinction entre les actions fondées sur l’un et sur l’autre pacte pour confirmer une incompétence partielle, mais statuer in fine sur la quasi-totalité du litige. Dans un cas comme dans l’autre, les solutions révèlent une mauvaise compréhension de l’article 1448 du code de procédure civile, la seule présence d’une convention d’arbitrage dans un pacte d’associé imposant au juge étatique...
Sur le même thème
-
Chronique d’arbitrage : le juge anglais, juge universel de l’arbitrage ?
-
Arbitrage international : la nouvelle donne
-
Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recours
-
Chronique d’arbitrage : le Conseil d’État enterre Galakis
-
Chronique CEDH : la lex sportiva prise dans les mailles du filet des droits de l’homme
-
Chronique d’arbitrage : variations autour de la compétence
-
Arbitrage, référé et date d’appréciation de l’urgence
-
Chronique d’arbitrage : à l’ami, à la mort
-
Droit de l’arbitrage internet et international : panorama 2022
-
Chronique d’arbitrage : Ukraine/Russie, la bataille juridique
Sur la boutique Dalloz
Code de procédure civile 2024, annoté
06/2023 -
115e édition
Auteur(s) : Pierre Callé; Laurent Dargent