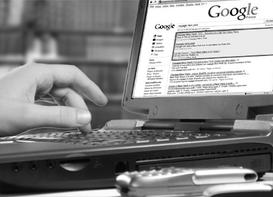A - Cadre juridique de la publicité personnelle de l’avocat
1. La communication passive de l’avocat
En ce qu’il n’est pas un commerçant mais un auxiliaire de justice assermenté, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité, c’est-à-dire à « la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées », mais cette autorisation de principe est soumise à des conditions strictes.
L’article 15 du décret n° 2005-790 du 21 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat pose, en effet, le principe selon lequel « la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ».
D’aucuns s’en souviendront, ce décret, dont l’article 15 est repris à l’identique à l’article 10 du règlement intérieur national (RIN) était venu assouplir les règles antérieures en posant le principe de l’autorisation de publicité personnelle de l’avocat, conditionnée au respect des principes essentiels de la profession et à l’interdiction du démarchage.
Mais la publicité autorisée à l’avocat est, en réalité, assez éloignée du sens qu’on lui connait traditionnellement. Ainsi, celle-ci ne peut emprunter les voies classiques de diffusion à savoir « les tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées » (art. 10.2 RIN).
Sous cette réserve, l’avocat est autorisé à recourir à « tous moyens légaux permettant d’assurer sa publicité personnelle ». Celle-ci pourra ainsi emprunter des formes moins traditionnelles aux nombres desquels l’envoi de lettres d’informations générales sur le cabinet, le droit et la jurisprudence, la diffusion de plaquettes de présentation du cabinet, l’apposition d’une plaque signalant l’implantation du cabinet à l’entrée de l’immeuble, ou encore la publication d’encarts publicitaires dans les annuaires ou dans la presse (art. 10.3 RIN).
L’avocat qui envisagerait de communiquer sur son activité en diffusant des informations sur les prestations de services qu’il propose n’est donc pas totalement démuni. Il n’en demeure pas moins que la plupart des formes de publicité autorisées ont, en réalité, une portée relativement limitée, et ce d’autant plus que leur contenu doit, en principe, demeurer neutre et exclusif de tout démarchage.
2. Le démarchage ou la sollicitation personnalisée de l’avocat
le démarchage consiste, selon règles déontologiques gouvernant la profession d’avocat, à « offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public. » (Décr. n° 72-785, 25 août 1972, art. 1er).
À l’inverse d’une publicité indirecte ou passive, le démarchage consiste à adresser « à un client potentiel », une « offre de service personnalisée » (Décr. n° 2005-790, 21 juill. 2005, art. 15), c’est-à-dire à prospecter activement de nouveaux clients qui n’ont pas manifesté un quelconque besoin de conseil juridique.
Jusqu’à récemment, le démarchage était unanimement prohibé par les règles déontologiques de la profession d’avocat, en tête desquels l’article 10.2 du RIN qui prévoit l’interdiction de « tout acte de démarchage (…) en quelque domaine que ce soit », et ce sous peine d’une d’amende de 4 500 € (9 000 € en cas de récidive), ainsi que d’une peine emprisonnement de six mois (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-4).
Mais l’entrée en vigueur, le 18 mars 2014, de la Loi Hamon relative à la consommation a mis un terme à cette interdiction générale, opérant ainsi une réforme majeure de la déontologie de l’avocat (L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 13).
Cette réforme, qui constitue « un pas important vers la banalisation de la prestation juridique » (D. 2013. Pan. 136, obs. T. Wickers
) et perçue comme la confirmation d’un mouvement qui tend à faire de l’avocat un simple prestataire de services au sens économique du terme. En témoigne, la présence de l’article 13 de la loi dans un Chapitre de dispositions visant à « améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs ».
À compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 est réécrit et prévoit désormais que « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires. »
Désormais, la proposition personnalisée de prestation de services faite par un avocat qui n’y aurait pas été préalablement invité et ce par tous moyens techniques de communication à distance, y compris par internet, est autorisée.
La fin de l’interdiction absolue et générale du démarchage était en réalité pressentie depuis que la Directive européenne n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (dites Directive « Services ») avait prévue « de mettre fin aux interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées (…) en levant les interdictions qui, de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs formes de communication commerciale (…) ».
Saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne avait, dans un arrêt 5 avril 2011, jugé que ce texte devait être interprété comme s’opposant à une réglementation nationale « qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage » (CJUE, 5 avr. 2011, aff. C-119/09, Sté fiduciaire nationale d’expertise comptable, Dalloz actualité, 7 avr. 2011, obs. X. Delpech ![]() ; D. 2013. 136, obs. T. Wickers
; D. 2013. 136, obs. T. Wickers ![]() ; RFDA 2011. 1225, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier
; RFDA 2011. 1225, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ![]() ;...
;...